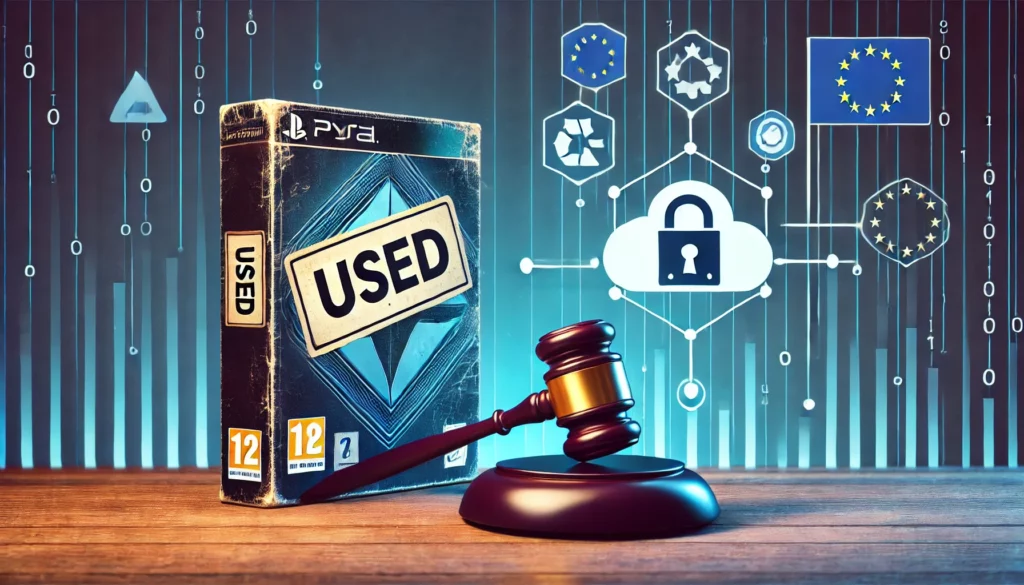Référence : Cet article s’appuie notamment sur les informations parues dans Le Monde, dans un article du 24 octobre 2024, qui rapporte la décision de la Cour de cassation en faveur de Valve/Steam et limitant le droit de revente de jeux vidéo dématérialisés (source).
Introduction
La question de la revente des jeux vidéo dématérialisés a récemment pris une tournure décisive en France avec une décision de la Cour de cassation limitant cette possibilité pour les consommateurs. Cette décision soulève de nombreuses questions juridiques et économiques, et nous met face à des contradictions dans l’interprétation du droit de la consommation entre les biens physiques et numériques. Si ce jugement semble freiner la revente de jeux dématérialisés, des voies de recours et des arguments demeurent pour les éditeurs et les consommateurs, surtout si l’on considère les bénéfices potentiels pour l’industrie.
1. La différence juridique entre les biens physiques et numériques
Traditionnellement, les jeux physiques sont protégés par le principe d’épuisement du droit de distribution, qui permet aux consommateurs de revendre un jeu acheté sous forme matérielle (disque, cartouche) une fois la première vente conclue. La possession physique du bien est donc interprétée comme donnant un droit de revente au consommateur, bien que les EULA (end-user license agreements) stipulent souvent l’inverse.
Dans le cas des jeux dématérialisés, cependant, les plateformes comme Steam, Epic Games Store, et autres optent pour des contrats de licence d’utilisation personnelle non transférable, empêchant juridiquement la revente par le biais de leurs conditions générales. La jurisprudence française considère que, n’étant pas propriétaires mais simples « licenciés », les consommateurs n’ont pas le droit de revendre ces biens dématérialisés. Cela crée un paradoxe puisque, bien que la possession d’une licence s’applique aux deux formats, l’épuisement du droit de distribution n’est juridiquement appliqué qu’au format physique.
2. Les contradictions juridiques entre la France et les États-Unis
Un autre aspect à noter est la divergence entre les législations française et américaine. Aux États-Unis, Valve (Steam) a récemment renforcé la notion de licence d’utilisation pour les jeux, en précisant aux consommateurs qu’ils achètent une licence d’accès (Steam : vous n’achetez pas vos jeux, mais juste une licence d’utilisation) et non un jeu en tant que bien physique. Cette clarification, si elle semble logique pour les biens dématérialisés, contredit toutefois le principe d’épuisement en Europe et, dans le contexte français, renforce le contraste entre les deux types de biens.
Ce paradoxe juridique pose des questions de cohérence : comment un même produit (un jeu) peut-il être à la fois revendable s’il est physique et intransférable s’il est numérique ? Pour les consommateurs et les éditeurs, cela représente une incohérence commerciale et juridique qui pourrait à terme être remise en question, soit par un tribunal, soit par une nouvelle législation.
3. La revente numérique : un atout pour les éditeurs et plateformes
Si l’on examine le marché des jeux vidéo dématérialisés, il est intéressant de constater que la revente numérique pourrait, paradoxalement, être un atout pour les éditeurs et les plateformes. Contrairement aux jeux physiques qui engendrent des coûts de production, de distribution et de logistique, la revente d’un jeu dématérialisé réduit ces coûts tout en offrant des opportunités de revenus additionnels pour les éditeurs. Voici comment :
- Contrôle des licences : en permettant la revente sous forme de licence transférable, les plateformes et éditeurs pourraient instaurer des frais de revente ou de transfert, captant ainsi une part des transactions d’occasion.
- Innovation technologique : des solutions telles que les QR codes ou les NFT pourraient être utilisées pour sécuriser et faciliter ces transactions, tout en offrant une transparence accrue sur l’origine et la validité de la licence revendue.
- Meilleure maîtrise des marchés gris : une revente encadrée permettrait aux éditeurs de maîtriser et de capitaliser sur ce marché secondaire, limitant les pratiques illégales et l’impact négatif des revendeurs non autorisés.
4. Les options de recours et les perspectives pour changer la législation
Pour contester cette décision de la Cour de cassation ou influencer un changement de la législation actuelle, plusieurs options sont envisageables, mais elles nécessitent une approche méthodique et souvent un investissement en temps et en ressources.
4.1. Saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Une voie possible serait de soumettre la question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette procédure nécessite qu’un tribunal national, au cours d’un procès, juge que le droit européen sur la revente des biens numériques nécessite clarification et décide de poser une question préjudicielle. Cela signifie qu’un utilisateur ou une association pourrait initier une action en justice en France pour revendiquer son droit de revendre un jeu dématérialisé. Le tribunal pourrait alors demander l’avis de la CJUE sur l’interprétation du droit européen, ce qui pourrait aboutir à une harmonisation des droits de revente pour les biens dématérialisés.
4.2. Plaintes et lobbying auprès de la Commission européenne
Une autre option est de mobiliser les associations de consommateurs et de protection des droits numériques pour porter des plaintes ou des pétitions auprès de la Commission européenne. Cette démarche permettrait d’attirer l’attention sur les incohérences actuelles et de promouvoir un cadre plus équilibré pour la revente numérique, avec des avantages pour les éditeurs et les consommateurs. Si la Commission juge la demande légitime, elle pourrait initier un processus de réforme.
4.3. Engager un dialogue public et médiatique
Un soutien public et médiatique pour le droit de revente des jeux dématérialisés pourrait exercer une pression sur les instances nationales et européennes pour qu’elles envisagent une réforme. Les éditeurs de jeux eux-mêmes pourraient s’associer à cette cause, s’ils réalisent les bénéfices économiques d’un marché secondaire encadré pour les biens numériques.
5. Négociation directe avec les éditeurs et plateformes : une solution pragmatique
Une autre voie, complémentaire aux recours juridiques et au lobbying, consiste à négocier directement avec les éditeurs et les plateformes pour les sensibiliser aux avantages économiques d’un marché de revente dématérialisé. En expliquant que la revente numérique, encadrée par des frais de transfert ou des solutions de sécurité comme les QR codes et les NFT, pourrait générer des revenus additionnels, les éditeurs et plateformes pourraient voir l’intérêt d’une réforme. Cette solution pourrait permettre une adoption rapide sans attendre une évolution législative ni passer par les longs processus de la CJUE.
Conclusion
La bataille autour de la revente des jeux vidéo dématérialisés est loin d’être perdue. Bien que la décision de la Cour de cassation en France impose actuellement une limitation, des voies de recours existent, notamment par l’intermédiaire de la CJUE, des actions de lobbying et des négociations directes avec les éditeurs. En parallèle, il est essentiel de souligner que la revente des biens numériques pourrait s’avérer avantageuse pour les éditeurs et les plateformes, tout en alignant les droits des consommateurs avec ceux qu’ils possèdent déjà pour les biens physiques.
Pour les éditeurs, les consommateurs, et les associations, cette cause pourrait symboliser une avancée vers une économie numérique plus juste et plus cohérente, mettant fin aux contradictions actuelles et ouvrant la voie à une nouvelle ère dans le secteur des jeux vidéo.