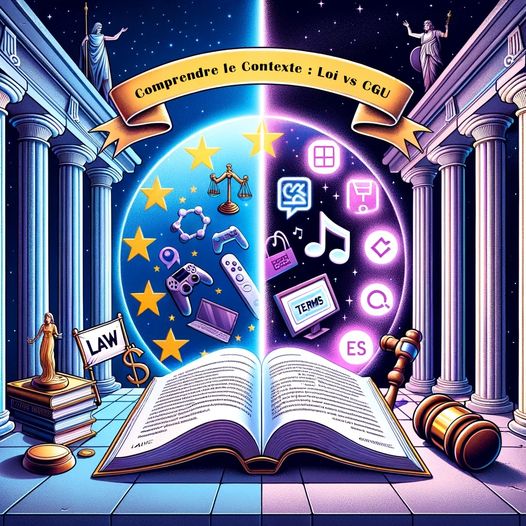Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre la distinction entre plusieurs termes juridiques souvent mentionnés lorsqu’il s’agit de droits des consommateurs et de jeux vidéo :
- Loi : Une règle ou un ensemble de règles adoptées par un organisme législatif et promulguées par l’exécutif. Les lois fournissent le cadre général que les citoyens et les entreprises doivent respecter.
- Application des lois : Cela concerne la manière dont les lois sont mises en œuvre ou appliquées. Dans certains cas, une loi peut exister, mais sa mise en œuvre peut être faible ou inexistante.
- Applicabilité des lois : Toutes les lois ne s’appliquent pas à toutes les situations ou à toutes les juridictions. Par exemple, une loi européenne peut nécessiter une transposition dans le droit national pour être applicable.
- CGU (Conditions Générales d’Utilisation) : Il s’agit des termes et conditions que les entreprises fixent pour l’utilisation de leurs services ou produits. Bien que ces termes soient fixés par l’entreprise, ils doivent respecter le cadre juridique en vigueur.
- Abus des CGU : Lorsque les termes d’une CGU sont excessivement désavantageux pour le consommateur ou violent certaines lois, ils peuvent être considérés comme abusifs.
- Pratique commerciale abusive : Il s’agit d’une pratique qui déforme le comportement économique du consommateur moyen ou qui est contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Elle peut être trompeuse ou agressive, et est souvent illégale.
Avec ces clarifications en tête, examinons de plus près la relation entre les CGU des plateformes de jeux vidéo et le cadre juridique français et européen.
Les CGU détaillent souvent les droits et les obligations de l’utilisateur et du fournisseur. Dans le contexte des jeux vidéo, ces règles peuvent aborder plusieurs sujets :
- Possession versus Licence :Les CGU indiquent généralement que l’utilisateur n’achète pas un jeu, mais une licence d’utilisation. Selon le droit européen, une fois qu’un produit (y compris un logiciel) a été vendu, l’éditeur ne peut plus contrôler sa revente.
- Revente de jeux dématérialisés :La CJUE a statué en 2012 (dans l’affaire UsedSoft vs Oracle) que le droit de revente s’applique aussi aux logiciels dématérialisés. Néanmoins, cette décision n’a pas été explicitement étendue aux jeux vidéo dématérialisés. La plateforme Steam, par exemple, interdit généralement la revente de jeux dans ses CGU. C’est ici que l’UFC-Que Choisir intervient, ayant contesté ces CGU et obtenu un jugement favorable affirmant le droit de revente de jeux vidéo sur Steam.
- Droit de rétractation :Les consommateurs ont un délai de 14 jours pour se rétracter d’un achat en ligne. Toutefois, ce droit peut être renoncé si le contenu numérique a été commencé à être téléchargé avec l’accord express du consommateur. Steam, par exemple, permet les remboursements sous certaines conditions.
- Suppression des jeux ou du contenu :Certaines plateformes peuvent retirer un jeu de leur catalogue, posant problème si un utilisateur a acheté ce jeu. La directive européenne 2019/770 pourrait être pertinente dans ce contexte.
- Limitations imposées par les CGU :Bien que les CGU puissent imposer certaines limitations, certaines pourraient être jugées abusives ou illégales, notamment si elles désavantagent le consommateur de manière disproportionnée.
En conclusion, bien que les plateformes de jeu vidéo établissent leurs CGU, elles doivent respecter la législation européenne et française. Les consommateurs disposent de droits spécifiques, et il est possible que certaines dispositions des CGU soient remises en question devant les tribunaux à l’avenir.