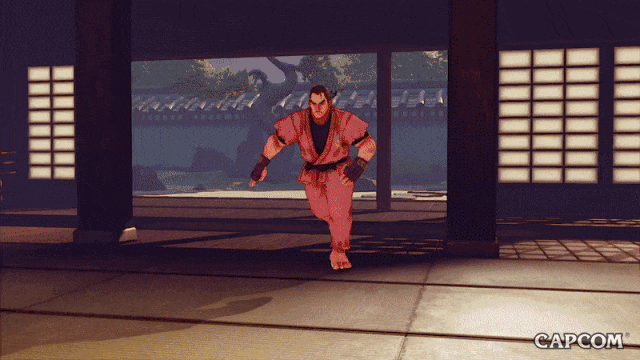L’INÉLUCTABILITÉ DU DÉMATÉRIALISÉ DANS LE JEU VIDÉO : ENTRE INNOVATION ET PRATIQUES BORDERLINE
L’évolution technologique du monde du jeu vidéo a vu une transition majeure du matériel vers le dématérialisé. Cette transition, bien qu’inéluctable, s’accompagne de défis juridiques et éthiques uniques. Les jeux vidéo, autrefois considérés comme des biens physiques achetés en magasin, sont maintenant souvent acquis sous forme numérique, éliminant ainsi la nécessité d’un support physique. Si cette innovation apporte commodité et facilité d’accès, elle est aussi source d’une foule de questions sur la propriété, les droits de revente et la conservation.
Les pratiques associées à la vente de jeux dématérialisés peuvent parfois flirter avec la légalité, notamment en ce qui concerne les droits des consommateurs. Par exemple, le droit de rétractation lors de l’achat d’un jeu dématérialisé, bien que prévu par la loi, peut être mis en défi par les conditions d’utilisation de certaines plateformes. De même, la notion de propriété est remise en question : un jeu acheté en ligne est-il réellement possédé par l’acheteur, ou s’agit-il simplement d’une licence d’utilisation ?
1. Revente de jeux dématérialisés :
1.1 Status actuel :
Le marché des jeux dématérialisés connaît une évolution cruciale, en particulier en France où l’UFC Que Choisir a remporté une victoire juridique majeure, mais pour le moment valable seulement pour Steam. Cette victoire pourrait potentiellement révolutionner le paysage numérique, si elle fait jurisprudence, permettant aux consommateurs de revendre leurs jeux numériques. Historiquement, la revente a été une pratique courante pour les jeux physiques, mais les jeux numériques ont été verrouillés par les licences des éditeurs.
Nouveau paradigme de la revente numérique : À la lumière de ces développements, une proposition innovante émerge. À l’image du marché des jeux physiques d’occasion où les titres ne sont pas rachetés et revendus au même prix – constituant la marge des revendeurs – le même principe pourrait s’appliquer aux jeux dématérialisés. La différence entre le prix de rachat et le prix de revente, qui peut être perçue comme une “taxe”, bénéficierait directement aux plateformes telles que Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Unreal, etc., et par extension, aux éditeurs.
Les critiques prédisent que cela pourrait réduire les ventes de jeux au tarif complet. Cependant, en limitant le nombre de jeux d’occasion à la réelle quantité de jeux effectivement revendus, l’impact sur les titres neufs serait modéré. Plus encore, cela pourrait s’avérer financièrement bénéfique pour les éditeurs. Les consommateurs n’ayant pas les moyens d’acheter un jeu au prix fort pourraient se tourner vers l’occasion. L’essence même d’un jeu “d’occasion” numérique serait un jeu déjà utilisé ou terminé par un joueur, indépendamment de l’usure physique potentielle, à l’instar des livres d’occasion qui, bien qu’ils puissent être en parfait état, ont déjà été lus.
Par ailleurs, cette proposition rappelle la période des années 1990 et 2000, marquée par le piratage informatique. Les éditeurs prétendaient alors perdre des revenus considérables, supposant que chaque jeu piraté équivalait à une vente perdue. Toutefois, la réalité est que beaucoup de ces “pirates” n’auraient jamais acheté les jeux en premier lieu, faute de moyens. Paradoxalement, le piratage a aussi joué en faveur des éditeurs en offrant une visibilité accrue à certains titres, indépendamment du fait qu’ils aient été achetés ou non.
1.2 Nature des droits d’auteur dans le jeu vidéo :Contrairement à d’autres domaines artistiques en France, les jeux vidéo n’ont pas de “droit d’auteur” au sens traditionnel. Ils sont régis par des accords de licence entre l’éditeur et le consommateur. Bien que les jeux soient produits par une multitude d’artistes (y compris les développeurs), Les droits relatifs aux créations des développeurs informatiques sont régis par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), en particulier les articles L. 113-9 et L. 113-10. Ces articles stipulent que, sauf disposition statutaire ou conventionnelle contraire, les droits sur les logiciels, et la documentation associée, créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur, sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. Cela signifie que le travail réalisé par un développeur pour une société appartient principalement à cette société, et non à l’individu.
Cette approche spécifique aux droits d’auteur en matière de jeux vidéo est centrale dans les débats juridiques récents. L’un des arguments clés qui a fait défaut à l’UFC Que Choisir lors de leur litige en 2015 concernait la notion d'”épuisement des droits”. En essence, un jeu vidéo ne peut être soumis à des droits d’auteur inexistants, car il est, sur le plan juridique, assimilé à un logiciel, régi par des contrats à différents niveaux. Malgré cela, il est crucial de souligner que même si les jeux vidéo sont traités comme des logiciels d’un point de vue juridique, ils restent indéniablement des œuvres d’art produites par plusieurs métiers artistiques. Cependant, ces créateurs ne sont pas reconnus comme “auteurs” à proprement parler. Quant aux éditeurs, bien qu’ils jouent un rôle déterminant dans le financement et la distribution, ils ne sont pas non plus considérés comme des auteurs, mais plutôt comme des entités financières et commerciales.
Rapport entre développeurs et éditeurs :Les développeurs, souvent passionnés par leur métier, sont fortement dépendants des décisions des éditeurs. Ces derniers, qui financent et distribuent les jeux, ont un pouvoir significatif, parfois comparé à celui des banques.
2. Achat, propriété et conservation des jeux dématérialisé:
2.1 Dépôt légal et préservation des jeux :
Selon la législation française (régi par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et modifiée par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015), tous les jeux disponibles en France doivent faire l’objet d’un dépôt légal et être conservés. Cela concerne aussi bien les jeux numériques, les jeux en ligne que les GaaS (Games as a Service).
Malgré les défis techniques associés à une telle conservation. Des solutions techniques doivent être envisagées pour répondre à cette obligation, qu’il s’agisse de rendre les serveurs open source, d’opter pour des serveurs de jeux plus standardisés et donc réutilisables, ou d’autres alternatives. De même, des entités institutionnelles, à l’image de la BNF (Bibliothèque nationale de France), devraient être en mesure de conserver des serveurs dédiés afin de préserver les jeux dans un état fonctionnel après l’interruption de leur service par les éditeurs, même si cela peut entraîner certaines limitations.
GaaS (Game as a Service) :Le GaaS représente un défi pour la conservation à long terme des jeux. Les consommateurs peuvent craindre de perdre l’accès à un jeu pour lequel ils ont payé, en raison de la nature éphémère de ces services.
2.2 La copie privée et les jeux dématérialisés : une remise en question des droits des consommateurs
Le droit à la copie privée est un pilier essentiel du droit d’auteur en France, garantissant aux individus la possibilité de réaliser une copie d’une œuvre acquise légalement pour un usage personnel. Institué par la loi n°85-660 du 3 juillet 1985, il s’agissait d’une réponse aux évolutions technologiques de l’époque, notamment l’arrivée des magnétoscopes, pour concilier les droits des auteurs et les nouveaux usages des consommateurs.
L’essor du dématérialisé dans le monde du jeu vidéo a toutefois généré des problématiques inédites en matière de droits des consommateurs. Alors que les jeux sur support physique peuvent être conservés, prêtés ou revendus à volonté par leur propriétaire, les jeux dématérialisés sont, quant à eux, soumis à des contraintes drastiques. Les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes numériques limitent, voire interdisent, la copie ou la sauvegarde locale des jeux, au mépris du droit à la copie privée.
Plus préoccupant encore, la nature éphémère des services en ligne expose les consommateurs au risque de perdre définitivement l’accès à leurs jeux dématérialisés. Si un éditeur décide de retirer un jeu ou de fermer un service, l’utilisateur se retrouve dépossédé d’un produit qu’il a pourtant légalement acquis. Dans cette optique, le droit à la copie privée prend tout son sens : il devrait permettre aux consommateurs de sécuriser leur investissement en réalisant une copie de sauvegarde.
Les éditeurs et plateformes de jeux dématérialisés se trouvent ainsi dans une position délicate, jonglant entre la nécessité de protéger leur propriété intellectuelle et le respect des droits légitimes des consommateurs. Le débat est loin d’être tranché, mais une chose est sûre : la question du respect du droit à la copie privée dans l’univers du jeu dématérialisé sera l’un des enjeux majeurs du droit d’auteur dans les années à venir.
3. Droits pertinents en jeu :
- Droit Français :
Code de la consommation :Article L221-28 : Restrictions au droit de rétractation lors d’achats numériques.
Article L221-5 : Obligation d’informer le consommateur sur son droit de rétractation.
Article L122-1 : Interdiction des ventes subordonnées.
Code civil :Article 544 : Définit le droit de propriété. Les jeux numériques, toutefois, ne sont souvent qu’une licence, et non une propriété au sens traditionnel. - Droit Européen :
Directive 2011/83/UE :Article 16 : Exceptions au droit de rétractation pour le contenu numérique.
Article 5 : Obligations d’informations claires sur le produit numérique.
Règlement (UE) 2019/1150 : Etablit des règles sur la transparence des conditions générales pour les plates-formes de médiation en ligne.
Conclusion :Le paysage juridique et économique des jeux vidéo en France et en Europe est complexe. Il navigue entre les intérêts des consommateurs, des développeurs et des éditeurs, tout en tenant compte des défis techniques et de conservation. La balance entre ces éléments reste un sujet de débat, nécessitant une vigilance constante pour s’assurer que toutes les parties soient équitablement représentées.